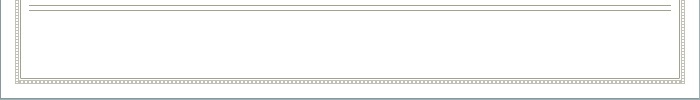Famille Hérault-Guilbault


Famille Hérault-Guilbault

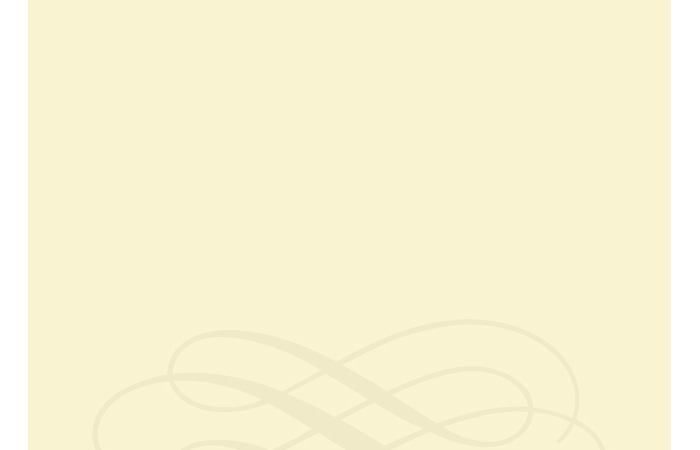
Les Hérault d’armes
Selon la tradition, les premiers hérauts seraient apparus sous Clovis.Mais il faut attendre le règne de Robert le Pieux (996-1031), pour voir des hérauts dans l'entourage du roi de France. A l'origine les hérauts étaient de simples serviteurs chargés d'apporter les messages. Cette institution se développe durant le XIIe siècle. C'est également à cet époque qu'apparaît dans la littérature française le terme <<hirou>> ou <<hiraut>> qui deviendra par la suite <<héraut>>.
Au début du XIIIe siècle, les hérauts sont recrutés dans la classe des ménestrels.Puis au cours du XIVe siècle, les fonctions évoluent.De simple messager, il devient l'ordonnateur des tournois et des joutes,ils identifient les participants d'une bataille à leurs écus ou leurs bannières. Les princes et souverains lui confient des missions diplomatiques.
L'apogée du héraut se situe aux XIVe siècle et XVe siècle puisque cette période est marquée par la vogue des tournois, des joutes et par les nombreuses batailles de la guerre de Cent Ans.
A la fin du Moyen-Age, il est un personnage important. Il cumule plusieurs fonctions concernant les jeux d'armes (joutes et tournois), la guerre, la chevalerie et l'héraldique.Il est à la fois technicien, conseiller et ambassadeur. Il est à l'emploi d'un Roi, d'un Prince, d'un grand feudataire ou d'une ville.
Comme plusieurs autres professions, il existe une hiérarchie chez les hérauts. On distingue le poursuivant d'arme,le héraut d'arme, le maréchal d'armes et enfin le roi d'arme. La carrière du héraut débute à vingt-cinq ans au moins et comme poursuivant d'arme. Les fonction se résument à être l'assistant du héraut qui l'a choisi. Il devra jouer ce rôle durant une période de sept ans avant de pouvoir accéder au titre de héraut d'arme.Au-dessus des hérauts se trouvent les maréchaux d'armes, un par <<marche>>. La marche est le nom donné aux grandes seigneuries qui forment le cadre de la noblesse militaire. Au sommet de la pyramide il y a le roi d'armes. Il est est choisi par la haute noblesse et il n'y en a qu'un seul par royaume.
Dès leur entrée en service les poursuivants et les hérauts reçoivent leur surnom au cours d'une petite cérémonie. Au début ces surnoms ne sont pas sans rappeler ceux des jongleurs ou ménestrels (Sotin,Coquasse).Mais à partir du XIVe siècle, les hérauts portent plutôt des surnoms qui rappellent le seigneur qui les emplois (Sicile,Saint-Pol, Bourgogne).
Ils sont baptisés par le Prince avec une écuelle de bois pleine d'eau pour les poursuivants,par un tasse pleine de vin pour les hérauts. Le roi d'armes pour sa part est baptisé avec du vin et reçoit en plus une couronne.
Étant donné leur fonctions, les hérauts portent un tenue qui leur permettent d'être reconnus de loin. Cette tenue consiste en un tabard, sorte de tunique plus ou moins fendue sur les côtés, armoriée du Prince ou de l'un de ses fiefs. Sous le tabard, il porte une cotte de maille afin d'être protégé des coups lorsqu'il traverse une mêlée lors d'une bataille. Mais, il apparaît sur les champs de batailles sans dague, épée, ni masse d'armes.Dans une bataille, le héraut guide les siens en désignant les adversaires grâce à leurs blasons.
A la guerre, le héraut d'un grand seigneur, présent à ses côtés, lui donne le nom de l'adversaire qu'il affronte puisqu'une bataille est faite d'une multitude de combats singuliers. Il dénombre les morts après la bataille et les identifie, grâce à sa connaissance du blason. Il sert aussi de messager d'un camp à l'autre. Son tabard aux armes de son maître fait office de drapeau blanc.
Les hérauts se font parfois écrivain, rédacteur de généalogies et de traités d'héraldique qui recense les armes des gentilshommes et de leur maison. Connaisseur en fait d'armes , ils se font parfois historiens. Les hérauts perdront au XVIe siècle une grande partie de leurs prérogatives et disparaîtront avec la monarchie.
Sources: Le héraut, expert comptable de la guerre féodale, Françoise Autrand, Historia no 55, Septembre-Octobre 1998
Les hérauts d'armes, François de Lanoy, Moyen-Age no 7, Novembre-Décembre 1998